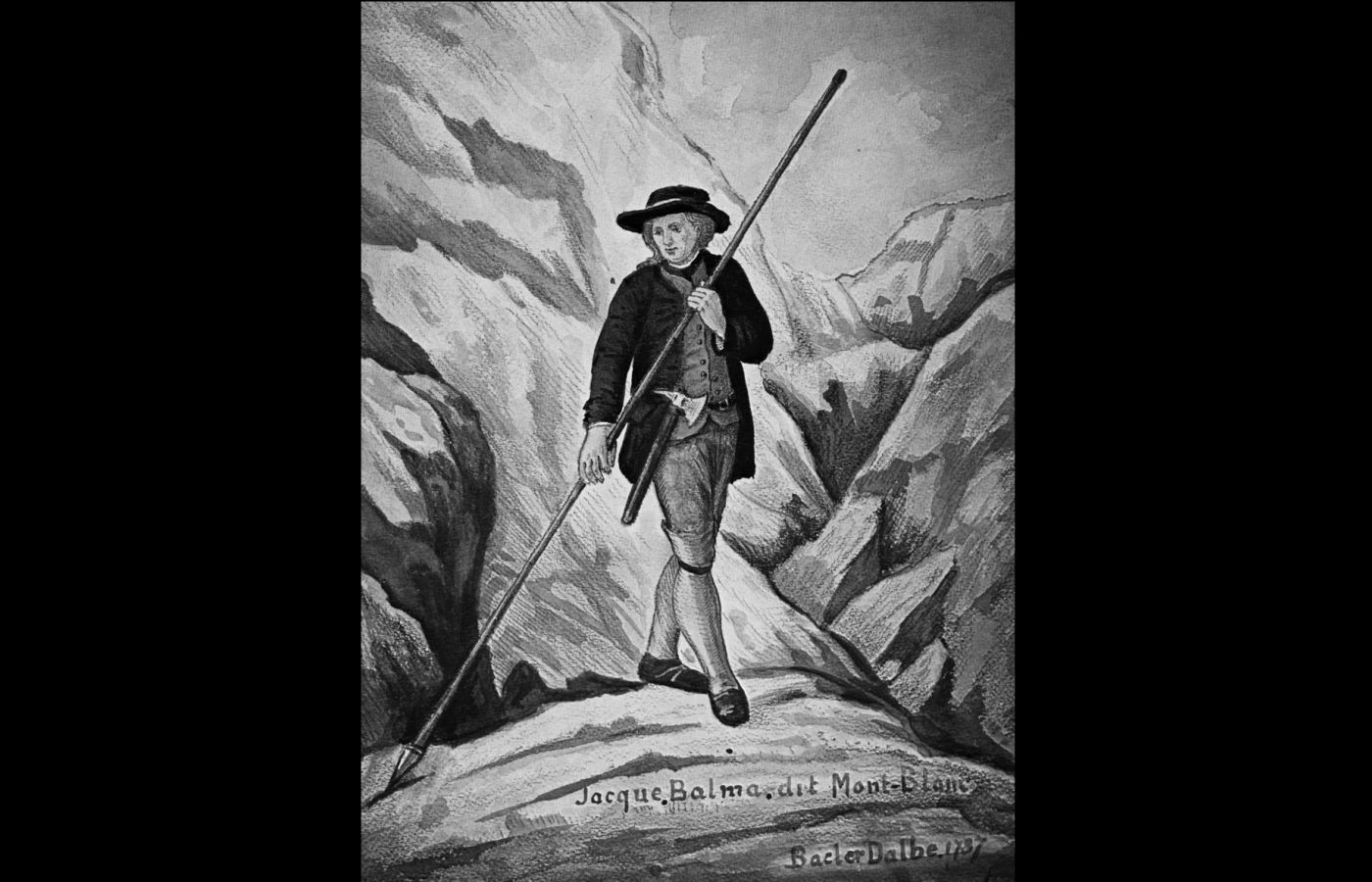Le grand jour
L’agriculture

Dans la vallée, on prépare le bétail qui va inalper. Là-haut, les bêtes se mêleront et ne formeront plus qu’un grand troupeau. Il est indispensable que les bergers puissent les reconnaître, les identifier si elles sont malades ou accidentées. Elles doivent aussi regagner chacune sa place à l’écurie, il faut les y conduire. Lors des « mesures de lait » prochaines, il est primordial que la personne qui est en charge de la traite connaisse le nom de la vache ainsi que celui de son propriétaire… Certes, les pelages des vaches sont tous différents, et il est possible de les identifier par un détail, une tache blanche ou une autre plus brune… Mais ce n’est pas si simple quand le plus petit des alpages accueille une cinquantaine de vaches, et le plus important cent soixante ! Il est alors impossible aux bergers de distinguer rapidement chacune d’entre elles.
L’article en images
-
 Légende photo :
Légende photo :La traditionnelle traite des vaches d’autrefois
-
 Légende photo :
Légende photo :Les bergers à Pormenaz
-
 Légende photo :
Légende photo :De très jeunes garçons se retrouvent face aux difficultés de mener le troupeau
-
 Légende photo :
Légende photo :Inscription gravée par un berger sur une dalle de schiste à la Charlanon
-

C’est pourquoi, une marque est apposée, indélébile, sur chaque bétail inalpé. Ce marquage peut se faire à l’arrivée sur l’alpage. Ainsi, en 1918 à Balme, les bergers se procurent « une bouteille d’ocre pour marquer les vaches« . Deux ans plus tard, ils achètent 500 grammes de minium « pour marquage du bétail le jour de l’inalpage ». Certains paysans préfèrent marquer eux-mêmes leurs vaches pour pouvoir les reconnaître au premier coup d’œil. Dessin de lignes géométriques entrecroisées, cette marque est choisie officiellement par la famille et peut remplacer, le cas échéant, une signature au bas d’un acte notarié. Le maréchal-ferrant a forgé cette forme géométrique et l’a soudée au bout d’une longue tige de fer. A l’autre bout, est fixée une poignée en bois. L’embout métallique, chauffé à blanc pour brûler en surface le cuir de la vache, ne provoque pas de blessure profonde. Elle empêche pendant plusieurs années le pelage de repousser et attestera le nom du propriétaire. Le même marquage peut parfois se faire sur la corne de l’animal.
On prête aux sonnettes des vaches de multiples vertus, dont les plus fantaisistes, colportées par la légende : la cloche éloignerait les vipères qui viennent se gorger de lait au pis des vaches ; une « reine » dépérirait et mourrait de « honte » si on la dépouillait de sa cloche ; le bétail sans cloche perdrait pied sur les pâturages glissants, cesserait de se débattre, fermerait les yeux et se laisserait couler sur le ventre au fond des précipices…
Plus sérieusement, la semi-liberté accordée aux troupeaux en montagne ne serait pas possible sans les repères audibles que constituent ces sonnettes. Avec des sons graves (carons) ou des tintements cristallins (clarines), elles s’entendent de très loin, malgré le brouillard, la pluie ou la neige. Comme les cloches des églises, les plus anciennes sont coulées en bronze et les habitants de la vallée se les procurent à Genève ou en Tarentaise. Parfois, un artisan se déplace et propose de couler sur place. Ce n’est qu’à partir de 1829 que deux forgerons de Chamonix se lancent dans la fabrication de la sonnette en acier : Simond aux « Praz-d’en-bas » et Devouassoud au « sommet du bourg ». La fabrique Devouassoud, fondée en 1801, emploie de nombreux agriculteurs-guides qui y trouvent un travail complémentaire précieux pendant l’hiver. Comme la sonnette Devouassoud, exhibée lors de l’exposition universelle de Paris de 1900, la sonnette Simond est « fabriquée en tôle d’acier fondu, estampée et cuivrée ensuite ; elle est d’une très grande solidité, d’une sonorité parfaite, et est incassable ; ces qualités jointes à sa grande légèreté l’ont fait préférer aux clochettes de bronze… » En 1901, 30 000 sonnettes ou sonnailles sortent chaque année de la forge Devouassoud où on utilise la force hydraulique de l’eau de l’Arve détournée dans un canal d’amenée. La fabrique Devouassoud perpétue au XXIe siècle les méthodes de fabrication familiales depuis six générations.
Enfin, que ce soit pour la traite ou pour la nuit à l’écurie, une bête doit être attachée. Les propriétaires fournissent aux bergers le matériel qu’il faut : de solides licols, grosses chaînes d’acier, et des passons (pachons), épais pieux de bois que l’on enfonce dans le sol et auxquels on attache les laitières pour la traite.
Enfin le jour tant attendu arrive. Cette année, l’hiver n’a pas été trop rigoureux et la montée à la montagne se fera très bientôt. Depuis quelques jours, les dates sont affichées à la mairie par les procureurs respectifs des montagnes.
Dans chaque village, on sait que le privilège d’inalper est réservé au seul consort et à son propre troupeau. Ce droit est en proportion du nombre de parts dont il est propriétaire. Les porteurs de demi-fonds doivent s’associer, ne bénéficiant de l’alpage qu’une année sur deux. Dans certains alpages, la part a été divisée en quatre héritiers, chacun pour un « pied » ; parfois même, huit personnes disposent chacun d’un « cocaton » (ongle, sabot de vache). Dans ce dernier cas, l’inalpage n’aura lieu qu’une année sur huit pour chacune des portions de parts.
Attention aux bonnes relations de voisinage : en 1842, les consorts de la Flégère interdisent à ceux des Chéserys « de faire passer leurs bestiaux sur la montagne de la Flégère pendant les cinq jours qui suivront l’inalpage de celle-ci à moins qu’on ne conduise ces bestiaux par le licol et sans causer de dommage. »
À quelques jours d’écart, on assiste à l’inalpage vers Chailloux ou la Flégère, d’abord, où la neige est déjà fondue, puis aux Chéserys et à Balme, et enfin à la Pendant et à Blaitière, situés versant ubac. Dans le froid du petit matin, de chaque maison, de chaque hameau, de chaque village, des groupes de quatre ou cinq vaches sortent de l’étable, une à une. Préalablement brossées et étrillées, elles ont reçu à leur cou de nouvelles cloches, plus lourdes et plus sonores. Elles se mettent en route, sonnettes tintinnabulantes, se dirigeant chacune vers sa montagne. Rejoignant les troupeaux des fermes voisines, des centaines de têtes de bétail marchent maintenant le long des routes et des chemins. Les familles conduisent leur troupeau : Charmante, Bijou, Violette… ou bien la Lionne, la Tigre… Aux côtés des adultes, les jeunes garçons prennent leur travail très au sérieux, interpellant les bêtes, les ramenant, lançant le chien vers celle qui s’écarte ! Des centaines de cloches mêlent leurs sons en une joyeuse et turbulente symphonie, les petits groupes fusionnent, constituent les poyas en longues files de bétail sur le chemin de l’alpage. Plusieurs dizaines de vaches se suivent, sans interruption, montant en file indienne les lacets serrés qui conduisent à la montagne.
Dans tous les villages, l’inalpage garde, encore aujourd’hui, un parfum de fête. En donnant au paysan l’assurance d’une pâture pendant tout l’été pour son bétail, l’inalpage est synonyme de sécurité et de tranquillité : le foin de vallée est économisé et engrangé, on tiendra tout l’hiver. Dans cette économie agro-pastorale précaire où la moindre intempérie se traduit par une récolte catastrophique, la certitude de disposer du fourrage nécessaire pendant la longue période de stabulation s’extériorise par un sentiment de liesse partagé par toutes les familles, y compris les enfants. « Notre récompense, si l’on avait bien travaillé à l’école, était de monter les vaches à l’alpage de Lognan » avoue Germaine Devouassoux (10 ans en 1916). « Nous avons marché sur la grande route jusqu’à la gare des Houches ; ensuite nous sommes montés doucement par Coupeaux ; là nous avons pris la petite route qui serpente à travers les sapins. (…) J’étais content d’avoir emmontagné à Merlet » écrit René Bochatay (9 ans) dans un texte libre à l’école des Bossons en 1947.
« C’était quelques jours avant les vacances, écrit Lucien Balmat (12 ans) dans un autre texte libre de cette même école l’année suivante. Depuis une semaine on pouvait lire sur une affiche à la mairie : « la montée à l’alpage de Balme aura lieu le jeudi 2 juillet. J’attendais avec impatience. Enfin arriva le mercredi. Nous avions décidé d’emmener deux vaches : La Lionne et la Mignonne. Le soir, je les étrillais. Elles brillaient de propreté. A minuit, le réveil sonna. Je me levai, me préparai et, le sac bien garni, partis sur la grand’route ; il faisait nuit. Les deux vaches me suivaient et leurs sonnettes tintaient fort dans le silence. Après quatre heures de marche, le pas commença à ralentir. Il restait encore sept kilomètres à parcourir sur un sentier caillouteux et la montée s’accentuait. Les vaches ralentissaient. Enfin, près du petit village du Tour, voici l’alpage de Charamillon et le col de Balme. Il est six heures et demie ; je suis arrivé le premier. Il fait frais : le soleil se lève sur le Mont-Blanc. Peu à peu les autres vaches arrivent, troupeau par troupeau. A midi, il y en a 154. Je « casse la croûte » à proximité de la chavanne. A trois heures, les bergers commencent à traire. Cela fait, ils sortent les vaches des écuries, les gens se groupent autour d’elles pour voir la bataille. La reine de l’an dernier se promène pour provoquer ses adversaires, mais aucune n’ose se battre avec elle : elle est la « reine ». Il est six heures, je redescends à pied. J’ai emmontagné. »
La montée ne s’effectue pas sans quelques batailles. Les vaches se connaissent, et, déjà, la lutte pour la hiérachie commence. Elle préfigure ce que sera, à l’arrivée à l’alpage, le combat des reines, où chaque année, une des femelles s’établit comme meneuse du troupeau. Les propriétaires accompagnant le bétail maîtrisent mais autorisent ces premières échauffourées qui permettent aux plus belliqueuses de lâcher un peu d’agressivité. Le vrai combat sera pour plus tard…
Les bêtes ont quitté l’étable depuis plusieurs heures, la montée est rude. Le sentier grimpe, raide et caillouteux, blessant les sabots. Il passe parfois au bord d’un à-pic, et il est alors indispensable de lancer au troupeau des mots rassurants. Des ruisseaux doivent être traversés, à gué ou sur des passerelles. Si les chèvres n’éprouvent aucune difficulté, il n’en est pas forcément de même avec le gros bétail.
Imagine-t-on l’emmontagnée à Bayer ? Elle commence par une montée au Montenvers et se poursuit par la traversée de la Mer de Glace. Equiper les sabots des vaches de chaussettes de laine antidérapantes, leur choisir le meilleur des passages à travers séracs et crevasses… une journée bien éprouvante pour le bétail comme pour les propriétaires. Cette note, écrite par Jean Michel Cachat dit le Géant en 1788 dans ses carnets, en dit long sur l’obligation d’exploiter toutes les pâtures, fût-ce au prix d’un danger extrême. « Le 1er juillet 1788 nous avons inalpé en Bayer ; tout allait bien en montant, mais ce fut le contraire en descendant. En effet, la Marie Josèphe Tournier femme de Jean Marie Tournier fils de Jean Marie Tournier des Bois est tombée sur le glacier d’une hauteur de 78 pieds ; elle s’en tira avec une cuisse cassée, une jambe très estropiée, le ventre un peu gâté et elle eut le grand bonheur de se guérir dans l’année. Je crois que je n’ai jamais porté une femme aussi pesante que celle-là pour la sortir du glacier ! »